Ou comment apprendre à ne plus se tirer une balle dans le pied juché sur des talons de 12.
R m’a récemment envoyé une publication — celle qui apparaît en fin de cet article — et à laquelle j’ai ajouté une traduction française. Cette publication, que je vous propose ici dans son intégralité, m’a frappé par sa justesse. Elle expose sans détour un certain nombre d’attitudes, de tics relationnels, de comportements propres à nos usages numériques et à nos relations affectives contemporaines. Il y a là quelque chose de « criant de vérité », non seulement parce que les observations formulées semblent viser juste, mais parce qu’elles dévoilent un miroir dans lequel il devient difficile de ne pas se reconnaître, même fugitivement. C’est agréable, parfois même apaisant, d’entendre quelqu’un formuler avec autant de clarté un portrait sans concession de nos contradictions, de nos distances émotionnelles, ou de nos manières d’aimer — ou de ne pas savoir aimer.
Cette publication fait écho à mon précédent article consacré à l’ouvrage « Ce que Grindr a fait de nous » de Thibault Lambert.
J’ai donc voulu commencer cet article par mes propres réflexions, celles qui s’imposent immédiatement après le visionnage de la vidéo.
Il y a, sur les réseaux sociaux, cette ritournelle désormais classique :
« Est-ce que les hétérosexuels vont bien ? »
La question est posée avec la douceur d’une lame de rasoir, toujours ironique. Les hommes cis hétéros (même si les femmes hétéros n’ont, elles non plus, aucun mal à alimenter ce florilège) sont exposés dans de courtes séquences qui révèlent toute la toxicité de cette masculinité hégémonique.
C’est affligeant et pitoyable de les voir déployer des trésors d’imagination pour mettre en avant et conforter une masculinité et une hétérosexualité dont la nocivité n’est plus à démontrer. Elle agit comme une machine à broyer tout ce qui ne rentre pas dans son moule (les femmes et les minorités principalement), mais elle détruit également les hommes eux-mêmes, prisonniers d’un système qu’ils perpétuent en croyant le maîtriser : celui des forts, des dominants.
En voyant ces séquences, on comprend rapidement pourquoi « les hétéros ne vont pas bien » est moins une moquerie qu’un constat de santé publique.
Mais derrière ce regard porté sur les dominants et les modes de domination, une autre question se fait pressante au sein de la communauté gay.
Plus inconfortable, elle n’en demeure pas moins oh combien nécessaire.
Et nous, les homosexuels, est-ce que nous allons bien ?
Sommes-nous (encore) capables — entre un lavement et deux afters — de lever les yeux de nos écrans Grindr pour réaliser un minimum d’introspection sur nos propres travers ?
Bon, okayyyyyy, nous ne contribuons pas autant que les hétéros à détruire notre planète. L’histoire de notre communauté et de nos luttes nous sensibilise, à priori, à être plus réceptifs aux souffrances et problématiques des autres minorités. Nos sexualités et systèmes de valeurs sont moins délétères d’un point de vue sociétal.
(EN THÉORIE)
Les homosexuels n’ont jamais envahi un territoire, déclenché une croisade, ni inventé les franchises de steakhouse où l’on donne aux burgers des prénoms masculins agressifs.
Nous n’avons pas cette capacité nocive et systémique, cette attitude de vainqueur qui permet aux hommes hétéros de poser leurs couilles sur la table et d’imposer leur propre vision du monde aussi nocive soit-elle.
Mais en revanche : nous savons très bien nous détruire nous-mêmes.
Ce que nous n’infligeons pas aux autres, nous l’infligeons souvent… à nous-mêmes.
Homophobie intériorisée, rejet social, racisme, drogue, solitude gay…
Là où les hétéros fabriquent des structures oppressives, les gays fabriquent des mécanismes d’autodestruction d’une efficacité redoutable.
Nous sommes une communauté qui, parfois, se tire une balle dans le pied — aveuglément, éhontément, et en pleine conscience (very mindful, very demeure) mais avec l’acuité d’un chasseur alpin.
Grindr est une sorte de capitalisme affectif poussé à son paroxysme.
Je ne reviendrai pas sur ce point que j’ai déjà abordé précédemment.
Le chemsex est devenu, dans nos villes, dans nos campagnes, une sous-culture structurée, presque ritualisée.
On se réunit à la nuit noire. Baisons avec des mecs auxquels nous n’adressons même pas une réponse sur les applications de rencontre ou même dans la vraie vie.
Sous l’effet des propriétés entactogènes et stimulantes de ces drogues, peu importe alors la personnalité ou le physique, pourvu qu’on ait l’ivresse, la bite bien dure et l’actif bien performant.
Pourquoi consommons-nous ?
Pour dissoudre la honte, la détestation de soi.
Pour éteindre la voix intérieure qui dit qu’on n’est pas assez séduisant, pas assez musclé, pas assez tout.
Pour créer un sentiment même factice d’appartenance, de communion, d’intimité, de chaleur humaine.
On dit y éprouver un certain plaisir, une sorte de méthode Coué, alors qu’au fond règne le même empire du silence et de la solitude.
Ce n’est qu’une illusion de communion, une intimité chimique qui disparaît à la descente.
On pense chercher l’extase : on cherche en réalité un lieu où ne plus être soi, celui peu reluisant que l’on n’ose affronter dans l’intimité de nos solitudes individuelles.
Le chemsex est moins une fête qu’un poison au travers duquel on a cru voir initialement un antidote.


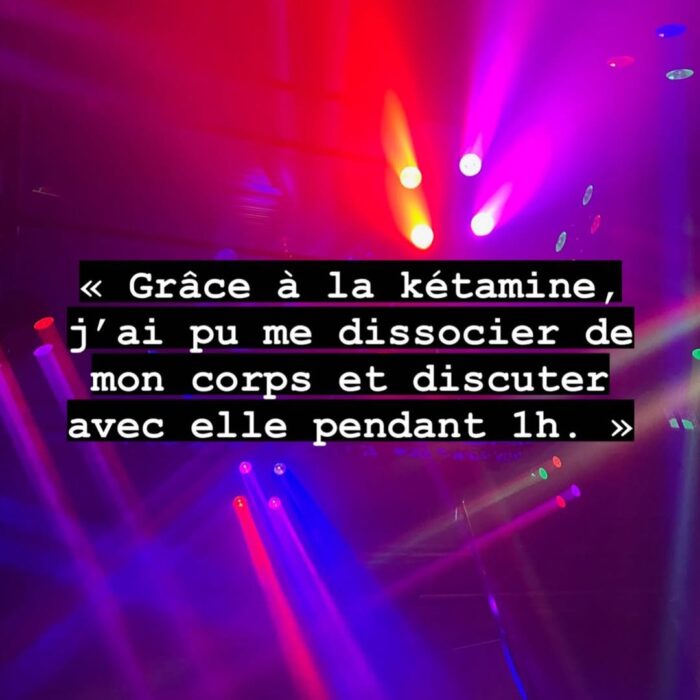
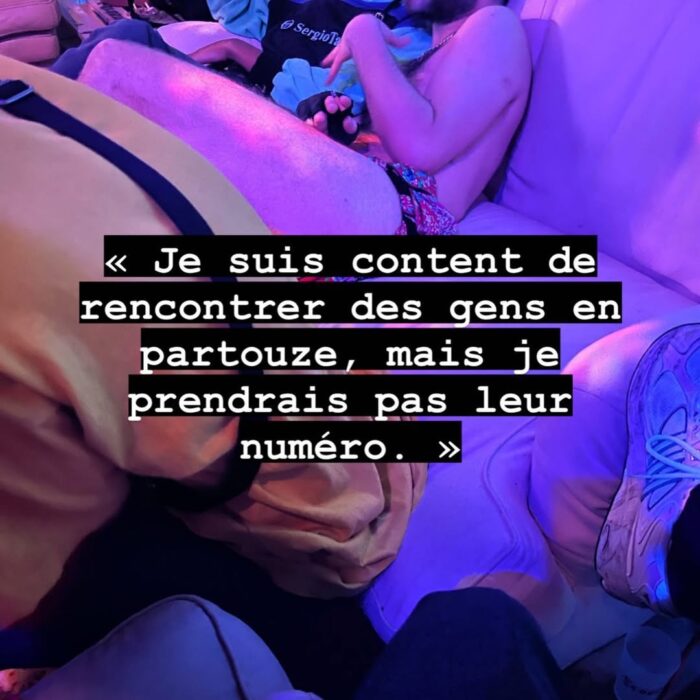
Amour liquide pour société liquide:
Nous vivons à une époque où l’on réclame la stabilité relationnelle, mais où l’on préfère malgré tout la volatilité des corps anonymes.
On dit vouloir le couple, mais à condition qu’il n’exige pas le sacrifice, ou l’engagement, qu’il n’exige pas l’abandon d’une sacro-sainte liberté sexuelle.
On dit vouloir la tendresse, mais seulement si elle n’entraîne aucun engagement émotionnel.
L’intimité nous effraie plus que le sexe.


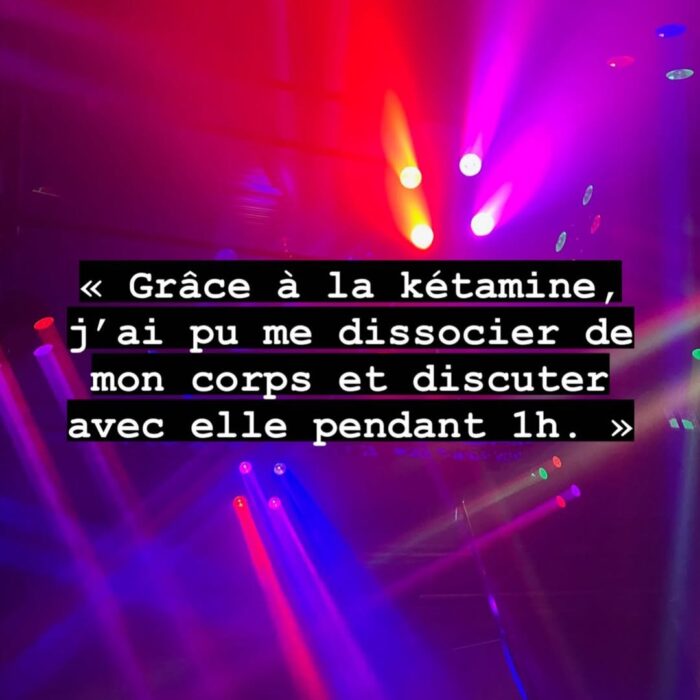
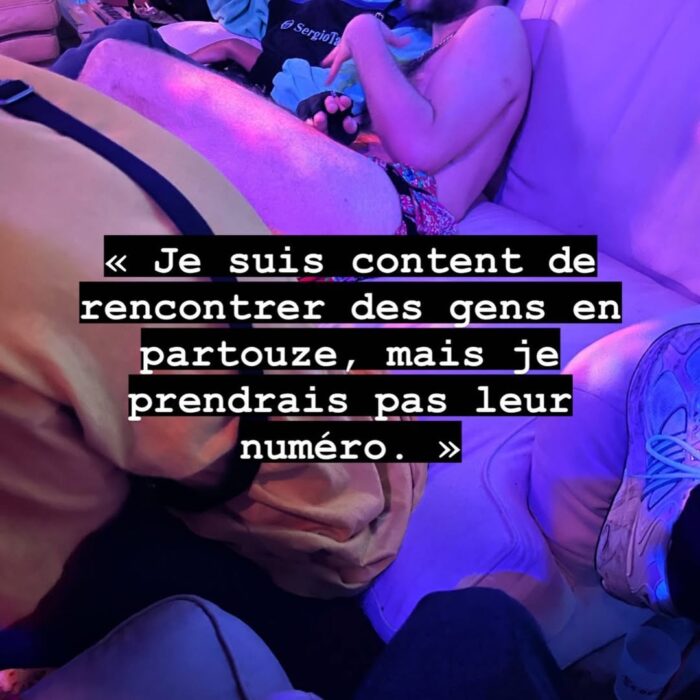
À titre personnel, je constate non sans « honte » qu’il m’est plus facilement concevable de faire un plan cul avec un mec sans discussions préliminaires que de simplement avoir un rencard au ciné, dans un bar ou un restaurant.
Le date nécessite un effort considérable car il convient de se préserver sous son meilleur profil, instaurer une complicité, être au top sans révéler de sa fragilité.
Le regard tendre nous terrifie plus que la pénétration.
Le « reste avec moi » paraît plus dangereux qu’un plan chemsex de douze heures.
Le résultat est un amour liquide, fluide, changeant, indiscipliné, fuyant, inconstant, plein de faux-semblants — au mieux tiède, rarement solide.
Comment s’en vouloir de s’essayer à un amour aussi labile quand il s’intègre dans une société tout aussi liquide ?
Qu’en est-il de nos amitiés ? Sont-elles présentes en dehors de simples beuveries, soirées, etc. ? Sont-elles faites de liens solides ou de la même hypocrisie, la même retenue et cette même peur de l’intimité, de la fragilité ? Ou reproduisons-nous, là aussi, les mêmes mécanismes de fuite ?
Sommes-nous prêts à la mise à nu que sous-tend une amitié, ou nous en protège-t-on autant qu’en amour ?

Dans la communauté gay, le corps n’est pas qu’un corps : c’est un passe-droit, un accès aux backstages, à la bagatelle.
Une hiérarchie visible, lisible et mesurable se dresse dans le milieu. C’est un système de vastes non-dits, un code tacite.
Les corps difformes, hors normes, vieillissants, gros, trop efféminés, trop noirs, trop maigres, trop velus : bref, ne répondant pas aux critères de baisabilité partent à l’écarrissage numérique.
À la clé de tout ça : de la dysmorphophobie, des troubles des conduites alimentaires, l’âgisme, le recours croissant aux stéroïdes anabolisants, à la chirurgie pour répondre aux injonctions de baisabilité.
On ne sélectionne pas un partenaire :
on sélectionne un physique.
On ne désire plus une personne :
on désire un stéréotype, une ombre chinoise.
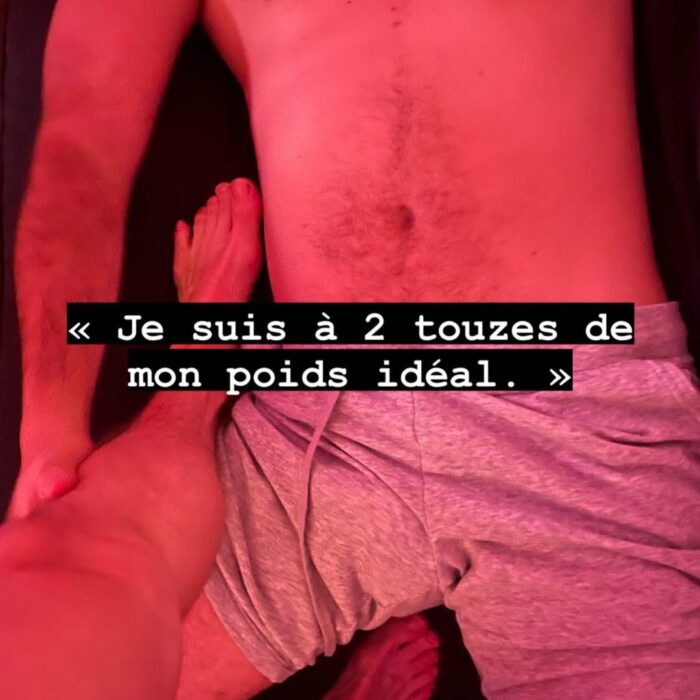
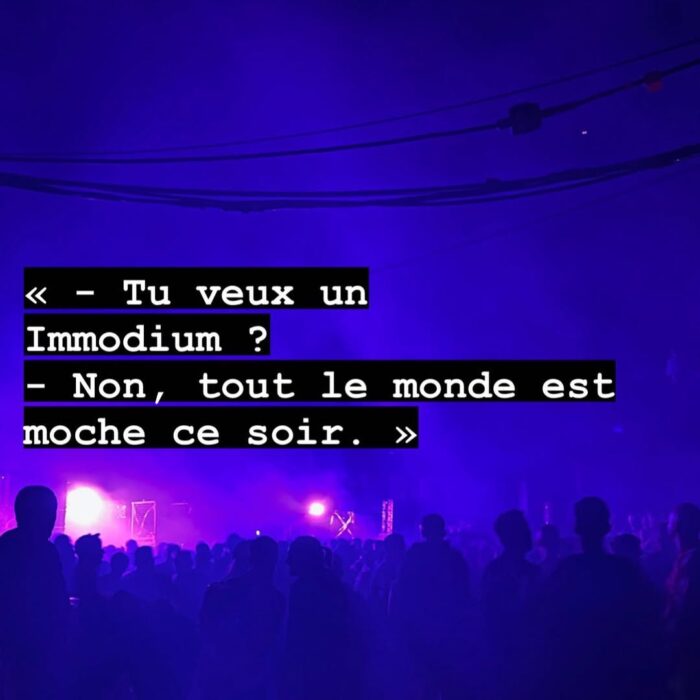


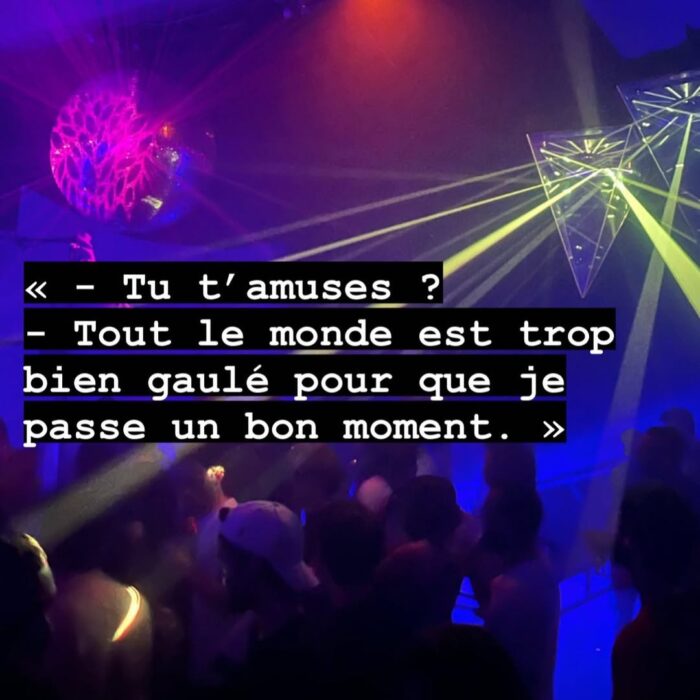
Bref,
Les hétérosexuels ne vont pas bien — mais nous non plus. Il serait trop facile d’utiliser les dysfonctionnements des hommes cis hétéros comme miroir rassurant.
Oui, le patriarcat est un désastre collectif.
Oui, il est structurellement violent. Mais la communauté gay ne va pas forcément mieux pour autant.
Nous ne détruisons pas le monde — mais nous nous abîmons souvent entre nous.
Nous ne dominons pas les autres — mais nous nous dominons nous-mêmes à coups d’injonctions au corps, à la performance.
Alors la vraie question n’est peut-être pas :
« Les homosexuels vont-ils bien ? »
mais plutôt :
Comment apprendre à nous aimer dans un monde qui ne nous donnera jamais les clés pour nous aimer nous-mêmes ?
Comment (re)devenir une communauté — pas un marché — et remettre le soin de l’autre au premier plan ?
Qu’est-ce qu’être gay en 2025 ? Je suis tellement heureux que vous posiez la question 🙂
Nous faisons tellement d’efforts.
Toute la semaine, nous travaillons sur nous-mêmes. Nous allons à la salle de sport, nous visualisons nos intentions, nous écrivons dans nos journaux, nous buvons des shakes protéinés, des jus de légumes, tout ce qu’il faut, au nom de cette quête pour devenir la meilleure version de nous-mêmes.
Et puis arrive le week-end.
Nous enfilons nos débardeurs, nous prenons quelques pilules, et nous allons à une nouvelle soirée « in-man-quable », remplie de gens qui ne nous connaissent pas réellement et, honnêtement, qui n’ont probablement aucune envie de le faire.
Nous dansons, nous transpirons ensemble, nous sourions. Nous disons « love you, girl » à des personnes qu’on oubliera certainement rapidement et qu’on ne recontactera même pas le lendemain.
Nous cherchons la validation d’une manière aussi vitale que l’oxygène l’est. Nous avalons et buvons tout ce qui peut anesthésier notre solitude — ne serait-ce que pour quelques heures.
Nous prétendons être fiers, mais en réalité, nous sommes juste fatigués.
Nous allons en soirée ou en festival alors que nous ne nous y sentons pas vraiment à notre place, tout ça pour danser avec des types qui ressemblent à des dieux grecs — alors qu’en vérité, ils n’ont pas mangé depuis trois jours et prennent assez de stéroïdes pour alimenter une ville entière.
Nous essayons de nous convaincre que nous avons confiance en nous, mais au fond, on se sent comme de la merde. Et quand vous pensez que tout ça ne peut pas devenir plus surréaliste, vous tombez sur le médecin de votre mère, qui prend des drogues — les mêmes drogues dont il recommande pas de s’en approcher.
Vous commencez à embrasser quelqu’un, et il vous écrit le lendemain ; immédiatement, vous vous dites : « Peut-être que c’est lui. Peut-être que c’est enfin le bon. » Et puis vient la discussion où il dit : « Je t’apprécie vraiment, vraiment beaucoup, mais je pense que nous devrions être en couple ouvert. ». Ce qui signifie, en réalité, qu’il aime bien l’idée d’un « nous », mais qu’en fait il s’aime surtout lui-même, et qu’il a par dessus tout peur de sacrifier une certaine forme de liberté.
Nous continuons à chercher à créer des liens dans une culture qui confond le besoin d’attention avec les relations vraiment profondes et intimes. Nous disons vouloir l’amour, mais ce que nous aimons vraiment, c’est la drague, le cul. Nous disons rechercher un sentiment d’appartenance, mais la seule chose que nous entretenons est une communauté fondée sur la comparaison et la codépendance affective.
Ne vous méprenez pas. Ne m’attaquez pas. J’adore être gay.
Mais être gay en 2025 n’est pas seulement difficile : c’est, parfois, profondément bouleversant.
Et pourtant, nous continuons à y revenir, encore et encore.
Nous continuons à danser, à espérer, à essayer de trouver quelque chose de réel dans un monde qui ne cesse de nous murmurer que nous ne sommes pas assez.
.

Les homos ne vont pas super bien en effet. 🙁 Mais je me demande à quel point ça n’a pas toujours été le cas, là c’est juste que les phénomènes s’amplifient avec le net et ses dérivés. Je n’y vois pas de trucs irrémédiables donc j’ai un peu d’espoir, même s’il y a urgence pour le chemsex qui est en train de détruire en profondeur trop de frangins.
Oui, les choses ne sont pas nouvelles. Les homos n’ont jamais été bien car ils évoluent toujours en périphérie, en parallèle de la « vraie vie ». On ne vit jamais trop qu’avec les hétéros, on les regarde mener leur vie sans être vraiment intégré à la société.
De tout temps, assumer son homosexualité a toujours été embrasser une vie de solitude et d’incompréhension. Chaque époque rajoute ses propres fardeaux et ses faux remèdes.
Je me rappelle de la fameuse phrase de la pièce Les garçons de la bande : « Montrez-moi un homosexuel heureux et je vous montrerai son cadavre ».
De tout temps, et le nôtre n’échappe pas à la règle, cette incapacité à être gay et heureux suscite l’inquiétude de beaucoup de mères : recevoir l’homosexualité de son fils est toujours synonyme de devoir faire le deuil du bonheur de son enfant.
« Attention, mon fils est gay : il se prépare à une vie de solitude et de tristesse. »
L’annonce de l’homosexualité d’un enfant est perçue par les parents comme un deuil anticipé. Ils vivent, sans arriver à le formuler et à le conscientiser :
la peur de la solitude de leur enfant,
la peur de la maladie,
la peur de la stigmatisation,
et la peur d’une absence de descendance biologique.
Même si la capacité des homos à être pleinement heureux est en grande partie une construction sociale, j’y vois vraiment un problème existentiel, ontologique, constitutif ; par conséquent, je suis, moi, enclin à souscrire à la remédiation de la chose.
Le chemsex est un fléau. On le compare avec l’épidémie de SIDA, mais là où la perte, les luttes ont eu des effets structurants, moteurs, entactogènes, l’épidémie de chemsex n’a pas ce pouvoir. Je suis jeune (et con) et je ne connais cette période que via les images, témoignages d’amis et la littérature, donc c’est plus de l’ordre du « fantasmé », du vécu par procuration, mais j’ai tout de même l’impression que l’électrochoc induit par cette épidémie a coagulé les affects, resserré la communauté. Cela a replacé un certain souci de l’autre au centre de la communauté. Il y avait une intersectionnalité des luttes, une communication entre les différents organes de la communauté (merci les lesbiennes).
Il y avait une conscience et un vécu aigu de la douleur qui a ouvert suffisamment de rage de vivre.
L’épidémie de sida a créé :
une communauté hyper-politique, une urgence collective, une culture militante (ACT UP),
une solidarité quotidienne, puis par la suite, une mémoire collective.
Le chemsex n’a pas ce « pouvoir » : on se regarde l’un l’autre se détruire, et on se détruit conjointement.
Il n’y a pas de récit héroïque du chemsex.
Il n’y a pas de mobilisation collective.
Il n’y a pas de “moment ACT UP”.
Paradoxalement, l’épidémie de chemsex a un caractère moins incurable que l’épidémie de VIH, mais on peine individuellement à trouver les leviers qui permettraient de s’en sortir.
Le chemsex a ceci de nocif : il anesthésie les affects, mais aussi la capacité à se mobiliser, à adopter une posture auto-réflexive.
Le chemsex tue moins vite mais abîme plus profondément, parce que c’est une expérience solitaire, interne, intime et silencieuse, une dégradation lente.
C’est dommage que la douleur et la souffrance soient les seuls hypercutes que la communauté connaisse. J’ai conscience d’être artisan d’une certaine esthétisation de la souffrance, d’un certain romantisme noir.
Mais
peut-être que le chemsex n’est pas suffisamment létal et mortifère. À mon sens, ce n’est pas l’électrochoc suffisant pour amorcer un vrai changement.